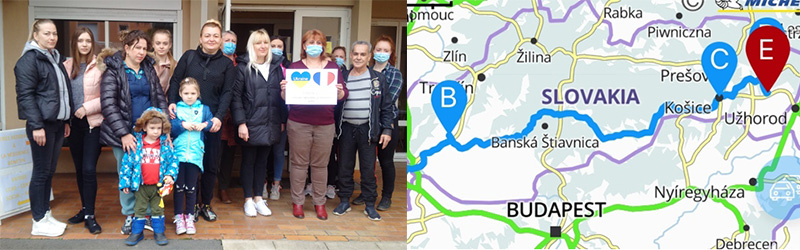Cluny et l’Italie, une très ancienne histoire
Dès l’origine, les moines de Cluny greffés sur Rome, n’auront de comptes à rendre qu’au pape. Ayant en commun avec l’Eglise romaine leurs deux patrons, Pierre et Paul, un lien existentiel et vital les reliera, assurant l’âge d’or de l’abbaye. Celle-ci en conséquence, appartiendra durant plusieurs siècles à la sphère d’influence romaine et italienne (1).

De la vallée de la Grosne à Rome, il y en aura des voyages ! Aux beaux jours, moines en mission et abbés, à cheval ou à dos de mulet, s’en iront par l’ancienne voie romaine qui de Cluny aboutit à Belleville-sur-Saône et de là vers les cols des Alpes. En Italie ils seront actifs. Implantant leur réforme ils établiront de nombreux monastères dont 14 adhèrent aujourd’hui à la Fédération des sites clunisiens. Ils obtiendront des papes privilèges et confirmations de propriétés, favorisant leur exceptionnelle extension en Europe. Ils tenteront de réconcilier quelques puissants seigneurs. Surtout, durant un siècle ils suppléeront les papes de Rome empêtrés dans les turpitudes de l’aristocratie romaine. Notons enfin qu’à la fin du XIe s. des moines clunisiens rejoindront la Curie romaine afin de constituer une Chambre des comptes sur le modèle de celle de l’abbaye. A Cluny, on savait compter !
En Gaule aussi, cet étonnant partenariat eut des effets durables sur l’expansion européenne de Cluny, la réforme de la société civile, l’architecture, la liturgie et l’art. Quelques faits :
- En 981, à l’occasion de la consécration de la deuxième église de l’abbaye, l’abbé Mayeul, acquiert à Rome des reliques des saints Pierre et Paul. De ce fait, Cluny devient une « petite Rome » et attire en nombre les pèlerins, surtout ceux de Francie et du nord de l’Europe.
- En 987, un jeune moine lombard, Guillaume de Volpiano accompagne Mayeul à Cluny. Il sera très vite l’abbé de St-Bénigne de Dijon et d’autres lieux. La construction de l’église de Chapaize lui doit beaucoup. Elle débuta en effet à la suite de son passage en 1021 et 1023, venu s’occuper du monastère Sainte-Marie. Guillaume influença à la manière lombarde, par ses origines, les nouvelles constructions (2). Fit-il venir comme on le dit, des maçons originaires de la province de Côme ? Comme l’écrivait Raoul Glaber, moine de Cluny, dans sa « vie de Guillaume de Volpiano » : « Trois années n’étaient pas écoulées dans le millénaire que, à travers le monde entier, et plus particulièrement en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises… » L’influence italienne – arcatures et frises lombardes – se retrouve dans les maisons romanes de Cluny et dans de nombreuses églises de Bourgogne.
- A la fin du XIe s. l’abbé Hugues rencontre en Italie du sud, son ami Désidérius, abbé du Mont-Cassin, qui termine la reconstruction de l’abbaye au moment où lui-même commence celle de Cluny III. Il en ramène un atelier d’artistes de haut vol qui réalisera probablement la grande fresque de l’abside, un Christ en majesté, détruite à la Révolution et celle de la Chapelle-aux-Moines de Berzé-la-Ville, inspirées de la tradition byzantine et de l’art italien.
Etc. etc. tant de choses encore ! Par exemple, la diffusion par les moines de la liturgie romaine. Plus prosaïquement, après la grande époque clunisienne, signalons l’apothicairerie de la Maison-Dieu de Cluny. Voyez ses faïences. Le mot vient de la ville de Faenza en Emilie-Romagne. A la fin du 16e s ses productions, dont des pots de pharmacie, étaient exportés dans toute l’Europe notamment en France et aux Pays-Bas. Les Maisons-Dieu, dont celle de Cluny soutenue par l’Association Julien Griffon, en possèdent encore.

Faisons un saut dans le temps. XVIIIe s., la Révolution ! La grande église de l’abbaye est quasi détruite. Nous sommes en 1810. Reste, entre autres, le grand portail roman qui fermait la nef. Une incongruité. La municipalité confia à deux ingénieurs sa destruction. Durant neuf jours ils bourrèrent d’explosifs l’envers du portail. Le christ roman polychrome explosa en mille morceaux. On en fit du remblai mais 6 000 fragments provenant de toutes les parties de l’avant-nef ont été sauvés de l’oubli en 1989 par les archéologues qui ont permis de restituer le tympan en 3D. Les ingénieurs qui portèrent le coup final à l’épopée clunisienne étaient… italiens. Quel paradoxe ! Et, vive le numérique qui peut faire oublier le vandalisme, la bêtise et le goût du lucre.
Aux XIXe et XXe s des milliers d’italiens émigrent en France. Nombre d’entre eux y font souche. De nos jours, les traces de leur présence marquent notre quotidien et souvent l’enchantent : artisans, intellectuels, artistes, entreprises, touristes, restaurants, cuisine, musique et chansons..
Robert De Backer
Maison de l’Europe
(1) L’empereur germanique, depuis Charlemagne, « protégera » ces Etats et confirmera l’élection du pape jusqu’en 1059, suite à la réforme grégorienne soutenue par les Clunisiens.
(2) Christian Sapin, La Bourgogne préromane : construction, décor et fonction des édifices religieux, Paris, Picard, 1986, p. 180.