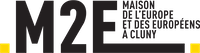La résilience : un nouveau visage de la résistance ?
De la Résistance historique à la résilience moderne, l’Union européenne adopte ce nouveau mot-clé pour affronter crises et construire un avenir durable.
L’action de résister a notablement gagné ses lettres de noblesse au cours de la Seconde Guerre mondiale avec les mouvements nationaux de lutte contre l’occupant : Résistants/Partisans en France, Partigiani en Italie, Andartes en Grèce, Partizani et Tchetniks en Yougoslavie…
Si ces appellations conservent encore une haute valeur emblématique au regard de l’Histoire, il semblerait qu’un terme à connotation voisine de celui de « résistance » ait pris de nos jours le relais : celui de « résilience ».
Conçu à l’origine dans le domaine de la physique pour caractériser l’énergie absorbée par un corps en déformation, puis dans celui de la psychologie en termes de réponse positive à un traumatisme, le concept s’est déplacé en particulier sur le terrain financier. Le cadre général a été dessiné au niveau international à partir de 1988 sous l’égide des « accords de Bâle », dont l’objectif est notamment de mieux appréhender les risques bancaires face à une situation de crise. Or, le 14 décembre 2022, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont adopté en leur qualité de colégislateurs un règlement dit « DORA » (Digital Operational Resilience Act) qui s’inscrit dans ce processus et vise à promouvoir une résilience numérique pour un grand nombre d’entités financières, au premier rang desquelles les établissements de crédit.
Dans une démarche encore plus extensive, le terme de « résilience » a connu récemment une authentique consécration à l’échelle de l’UE dans le contexte des soubresauts engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. C’est en effet dans cette conjoncture aux multiples retombées qu’à la suite d’une initiative de la Commission européenne les mêmes colégislateurs avaient déjà adopté, le 12 février 2021, un règlement établissant une Facilité pour la reprise et la résilience. Cet instrument constituait la pièce maîtresse du programme « NextGenerationUE », doté d’une enveloppe de 723,8 milliards d’euros de crédits à mobiliser en faveur des États membres de l’UE pour neutraliser l’impact de la pandémie sur le court terme mais aussi pour augmenter la croissance potentielle de l’Union à moyen terme et renforcer sa résilience sur le long terme selon une approche de développement durable.
C’est également dans cette dynamique – mais cette fois en réponse aux perturbations du marché de l’énergie liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qu’en mai 2022 la Commission de Bruxelles a présenté l’initiative RePowerEU destinée à se passer du gaz, du pétrole et du charbon en provenance de l’État envahisseur d’ici à 2027. Bien que le terme de « résilience » n’apparaisse pas expressément dans l’intitulé de la proposition, la connotation y était sous-jacente. On ajoutera que la Commission, après avoir surmonté un certain nombre de tâtonnements, vient de lancer, début février 2025, l’élaboration d’une stratégie globale de résilience de l’eau – un thème inscrit avec d’autant plus de conviction parmi les priorités de l’Union qu’il figure officiellement dans l’intitulé du portefeuille attribué à Jessika Roswall, commissaire aujourd’hui chargée de l’environnement.
Comme on peut l’observer, la notion de « résilience » a progressivement acquis un droit de cité appréciable dans le « discours européen ». Il n’est, du reste, pas anodin de souligner que, précisément, dès son premier discours sur l’état de l’Union (septembre 2020) – qui portait notamment sur des thèmes tels que la santé, la migration, le climat et la relance – Ursula von der Leyen, présidente de la Commission alors nouvellement investie, a employé ce vocable à de nombreuses reprises, telle une sorte de clause d’un engagement politique qu’apparemment elle n’est sans doute pas prête de souhaiter… résilier.
Gérard Vernier